Genève (Suisse). Grand Théâtre. Mercredi 22 janvier 2025
Le Grand Théâtre de Genève présente une Salomé de Richard Strauss somptueusement
dirigée pour la première fois par l’enthousiasmant Jukka-Pekka Saraste à la
tête d’un Orchestre de la Suisse Romande aux couleurs chatoyantes, avec de
brillants Hérode (John Daszak), Jochanaan (Gábor Bretz), Narraboth (Matthew
Newlin), Herodias (Tanja Ariane Baumgartner), Page (Ena Pongrac), quintette de
Juifs, une Salomé féline mais criarde (Olesya Golovneva). Convaincante direction
d’acteurs mais des points de vue contestables du metteur en scène Kornél
Mundruczó qui transpose l’action à New York dans une sorte de Trump Tower où
festoie Hérode-Donald, qui va jusqu’à violer sa belle-fille dans le réduit où
est enfermé le prophète… Tandis que dans la scène finale les ouvertures de la
tête du Baptiste sont pénétrées par sept Salomé…
Parmi les témoins qui ont assisté à
la première représentation autrichienne de Salomé,
dirigée par Strauss au Stadttheater de Graz le 16 mai 1906, sont toujours cités
les noms de Gustav Mahler, Giacomo Puccini, Alexander Zemlinsky, Arnold
Schönberg et ses disciples Alban Berg, Anton Webern et Egon Wellesz entre
autres, ainsi que des écrivains comme Stefan Zweig ou Arthur Schnitzler, le scénographe Alfred
Roller, il est un nom qui est généralement négligé, celui d’Adolph Hitler, ce
que Richard Strauss rappelait en 1939, lorsqu’il apprit que toute
représentation de sa Salomé était interdite sur tout le territoire du
Reich, il écrit à son neveu, le chef d’orchestre Rudolf Moralt, qu’en 1934, à
Bayreuth, Hitler lui parla à l’issue de la première de Parsifal qu'il venait de diriger. « L’idée que Salomé
serait une ballade juive ne manque pas de sel. Le chancelier du Reich en
personne a dit à mon fils, à Bayreuth, que Salomé était l’une de ses
premières expériences dans le domaine de l’opéra, et qu’il avait obtenu
l’argent du trajet pour aller assister à la première de Graz en sollicitant sa
famille. Ce n’est pas une blague !!! » A n’en pas douter, comme le
suppute Richard Strauss, c’est certainement la scène des Juifs qui aura à la fois le plus
séduit et le plus choqué le futur Führer, malgré la teneur musicale annonciatrice du
dodécaphonisme de ce passage… A ce propos, Strauss rappelait à Stefan Zweig alors qu’ils
travaillaient tous deux sur Die schweigsame
Frau (La Femme silencieuse) qu’ « en écrivant Salomé, je voulais faire du brave
Jean-Baptiste plus ou moins un bouffon : pour moi un homme qui prêche
ainsi dans le désert et qui par surcroît se nourrit de sauterelles a quelque
chose d’indescriptiblement comique. Et c’est seulement parce que j’avais déjà
persiflé les cinq juifs et copieusement caricaturé le père Hérode que j’ai dû
me limiter pour le Baptiste, selon les lois du contraste, au ton philistin et
maître d’école de quatre cors. »
Certes, côté mise en scène, il faut
libérer le premier authentique chef-d’œuvre scénique de Richard Strauss qui lui
permit de faire bâtir sa villa de Garmisch-Partenkirchen, de ses clichés
scénographiques, avec citerne centrale obligée enfermant le dernier prophète
chargé de la venue du Messie, mais peu de conceptions sortant de cette proposition
ont réussi à convaincre au point de prévaloir entre la création de l’œuvre au
Staatsoper de Dresde le 9 décembre 1905 jusque dans les années 2000. La
proposition du Grand Théâtre de Genève transpose l’action dans un décor et des
costumes contemporains conçus par Monika Korpa, un vaste hall aux murs couverts
de teck et de dorures avec rivières de lumière et vidéo-surveillance d’un très
grand appartement new-yorkais occupant le sommet d’un building huppé où montent
de temps à autres les cris de manifestants ou d’émeutiers hurlant dans les rues
alentour, tandis que l’on assiste aux agapes de cette société de parvenus
autour d’une longue table richement ornée. Sur ce hall donnent deux portes dotées
de hublots qui permettent d’élargir l’action, celle côté jardin ouvrant sur la
remise où est retenu Jochanaan, longue silhouette dégingandée à la chevelure indomptée,
tandis que, actualisation oblige, Hérode adopte plus ou moins la stature et le
comportement d’un certain Donald Trump, et que le page d’Herodias est un être androgyne
(ou transgenre si l’on adopte la terminologie en vogue), robes courtes blanches
pour les femmes, costumes trois pièces cravates pour les hommes et veste
blanche pour les serviteurs, la décollation du Baptiste se faisant hors de
portée de vue dans le cagibi du fond, et la tête coupée n’étant pas apportée à
Salomé sur un plarteau mais apparaissant sans chevelure sous forme de sculpture géante de laquelle sept Salomé sortent et entrent sur le plateau par les yeux, les
oreilles et le nez durant la scène finale, soulignant l'obsession de la jeune fille tandis qu’Hérode s’affole au sommet du crâne avant de hurler l’ordre de « tuer cette femme »
Quant à la danse, il serait peut-être
bon que les metteurs en scène et chorégraphes qui se voient confiés l’ouvrage se
plongent dans les écrits de Richard Strauss, même si leur mission est
assurément la créativité donc l’obligation de proposer une conception personnelle
et non pas de respecter dévotement les recommandations des auteurs. En effet,
ce qu’ont donné à voir Kornél Mundruczó et Csaba Molnar est plutôt trash,
allant jusqu’au viol effectif de Salomé par son beau-père devant les yeux de sa
mère, là où le compositeur refusait tout aspect « théâtral ». « Pas
de flirt avec Hérode, précisait-il à un metteur en scène en 1930, pas de
comédie près de la citerne de Jochanaan. Juste un moment d’arrêt près de la
citerne sur le dernier trille. La danse devrait être purement orientale, aussi
sérieuse et mesurée que possible, et parfaitement décente, comme si elle était
exécutée sur un tapis de prière. Le mouvement ne doit devenir plus soutenu
qu’avec l’ut dièse mineur, et la dernière mesure à 2/4 devrait présenter une
légère insistance orgiaque. »
Sur le plan musical, la soirée est réjouissante. Depuis l'estrade de la fosse, Jukka-Pekka Saraste donne à l’orchestre le rôle central qui agréerait au
compositeur. De cet opéra de l’obsession, avec Narraboth qui ne songe qu’à
Salomé, Salomé à Jochanaan, Jochanaan à sa haine pour Hérode, les Juifs par
leur dogme religieux, Hérode par Salomé, Hérodias par son envie de vengeance
et, pour finir, Salomé par la tête tranchée de Jochanaan, le chef finlandais
explore avec la centaine de musiciens (Strauss réalisa une version pour
soixante-cinq instrumentistes pour la fosse de l’Opéra de Graz) de l’Orchestre de
la Suisse Romande réussit à dépeindre avec art cette sombre pathologie de tous les personnages qui, tel un flot de savoir, révèle ce qui est
tapi dans le cœur et dans l’esprit des protagonistes avant même qu’ils en aient
conscience. Saraste anime avec nuance et intensité dramatique un orchestre qui
se plaît à relever les défis de la partition de Strauss, ne craignant pas de
prendre quelque risque, particulièrement côté cuivres.
Sur le plateau, la soprano russe Olesya
Golovneva est une Salomé féline, fébrile, opiniâtre, mais la voix est tendue au
point d’émettre une certaine acidité dans l’aigu qu’elle tend à crier. Le
baryton-basse hongrois Gábor Bretz est
un Jochanaan fataliste, vocalement impressionnant doté de graves amples et sûrs,
le ténor britannique John Daszak au timbre bien trempé et puissant campe un hallucinant
Hérode, la mezzo-soprano allemande Tanja Ariane Baumgartner une Herodias
majestueuse et vindicative, le ténor états-unien Matthew Newlin un Narraboth
solide et séduisant, la mezzo-soprano croate Ena Pongrac un excellent page d’Herodias,
les cinq Juifs (Michael J. Scott, Alexander Kravets, Vincent Ordonneau, Emanuel
Tomljenovic et Mark Kurmanbayev également premier soldat), ainsi que les deux
Nazaréens (Nicolai Elsberg également second soldat, et Rémi Garin) et le
Cappadocien (Peter Boekeun Cho) complètent la distribution de remarquable façon.
Bruno Serrou





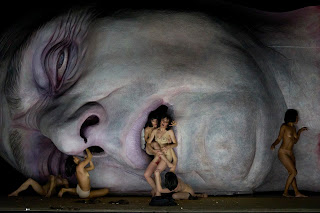
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire