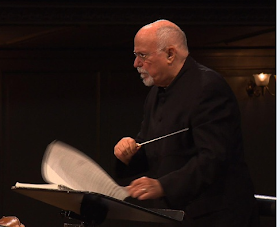Opéra de Paris Garnier. Mercredi 10 février 2016
La conférence Saison 2016-2017 de l'Opéra national de Paris, Palais Garnier, mercredi 10 février 2016. De gauche à droite : Luca Francesconi, Benjamin Millepied, Stéphane Lissner et Philippe Jordan. Photo : (c) Bruno Serrou
Stéphane Lissner a présenté ce
mercredi matin sa deuxième saison à la tête de l’Opéra national de Paris.
Entouré de son directeur musical, Philippe Jordan, et du directeur de la danse,
Benjamin Millepied, qui présentait pour sa part sa seconde programmation, une
semaine après avoir annoncé son départ de l’auguste institution.
Le directeur de l'Opéra de Paris s’est d’abord
félicité du succès des diverses nouveautés qui ont été mises en place par ses
équipes au début de la saison en cours, le Troisième Scène, qui, avec
vingt-deux œuvres originales à son catalogue d’artistes venus des arts
plastiques, de la photographie, de la musique, du cinéma d’animation et de
fiction, de la littérature, de la danse et des nouvelles technologies qui a
déjà suscité huit cent trente quatre mille cinq cents vues, le nouveau site
Internet, le large écho des réseaux sociaux qui totalisent quatre cent
cinquante et un mille abonnés, le grand écran posé sur la façade de l’Opéra
Bastille, qui, au-delà des informations qu’il distille, diffusera en direct le
concert que l’Opéra de Paris organisera le jour de la Fête de la Musique, le 21
juin, tandis qu’il alertait sur l’arrivée pour la prochaine saison d’une
nouvelle application
operadeparis pour smartphone.
Avant de passer à la
programmation, mettant sur la piste du slogan décliné sur la totalité du
matériel promotionnel de l’Opéra de Paris, « l’Opéra n’attend que vous »,
son directeur a annoncé la mise en place de « tarifs adaptés » à la
conquête de nouveaux publics, tandis que le prix des places continuent de s'envoler dans certaines catégories, surtout lorsque les stars sont au rendez-vous des productions. Seront ainsi proposées deux cent quatre vingt
deux mille places à 50€ et moins, dont trente mille avec la mise en place d’une
nouvelle catégorie pour le lyrique. A ce propos, Lissner s’est félicité du fait
que trente-huit pour cent des personnes ayant bénéficié de l’offre découverte initiée
en janvier sont de nouveaux spectateurs. Des places de 10 à 30€ pour Les midis
musicaux et les week-ends de musique française et romantique, des spectacles
jeunes publics à 5€ pour les moins de 15 ans, quinze avant-premières à 10€ réservées
aux moins de 28 ans, enfin un nouvel abonnement « en famille » et des formules d’abonnements jeunes de 64 à
91€ pour quatre spectacles, enfin un nouvel abonnement « en famille »
offrant une remise de 50 % pour les jeunes de moins de 18 ans accompagnant un
adulte, à partir de quatre spectacles.
La programmation 2016-2017
Trois siècles et demi d’art
lyrique seront parcourus de septembre 2016 à juillet 2017, de 1667, avec l’arrivée
au répertoire d’un opéra de Pier Francesco Cavalli, à 2017, avec la création
mondiale d’un autre compositeur italien, Luca Fancesconi.
Créations
Ce sont donc deux création/recréation
lyriques qui constituent l’alpha et l’oméga de la prochaine saison. Programmée
en ouverture de saison, du
14 septembre
au 15 octobre 2016, le premier ouvrage est
Eliogabalo, opéra
sulfureux en trois actes de
Pier Francesco
Cavalli (1602-1676) dont le livret d’Aurelio Aurelli conte le règne aussi
dissolu et violent que bref et démagogique de l’empereur romain Héliogabale,
massacré par la foule à l’âge de 18 ans après trois ans et huit mois à la tête
de l’empire. Dirigée par Leonardo Garcia Alarcon à la tête de l’Orchestre
Cappella Mediterranea et du Chœur de Chambre de Namur, et mise en scène par
Thomas Jolly, qui a présenté les grandes lignes de son projet scénique, la distribution
réunira entre autres Franco Fagioli dans le rôle-titre, Paul Groves, Nadine
Sierra et Valer Sabadus.
Luca Francesconi (né en 1956). Photo : (c) E.-Bauer/OnP
Mais la véritable création,
commande de l’Opéra de Paris, est le premier fruit du thème de la littérature
française dans la création lyrique annoncé voilà un an par Stéphane Lissner. Il
s’agit de
Trompe-la-Mort que
Luca
Francesconi (né en 1956) - qui avait composé son opéra
Quartett à la demande de Lissner pour la Scala de Milan - a adapté de
Splendeurs
et misères des courtisanes et d’
Illusions
perdues d’Honoré de Balzac (1799-1850). Cet opéra en deux parties reliées
par un interlude instrumental fait appel à un orchestre plutôt fourni sans électronique. Il sera
dirigé par Susanna Mälkki, et réunira un chœur à quatre voix. Les douze rôles
sont confiés entre autres à Thomas Johannes Mayer, Julie Fuchs, Cyrille Dubois
et Jean-Philippe Lafont. Présentée du
13
mars au 5 avril 2017, cette
création est mise en scène par Guy Cassiers.
Il est à noter que les prochaines créations programmées ont été confiées à
Michael Jarrell, qui a choisi la
Bérénice de Jean Racine en
2017-2018 et à
Marc-André Dalbavie qui va avoir la lourde tache de tailler dans l'immense
Soulier de Satin de Paul Claudel dans la perspective de la saison
2018-2019...
Stéphane Lissner, directeur de l'Opéra de Paris, entouré de Benjamin Millepied, directeur de la danse (à sa gauche) et de Philippe Jordan, directeur musical (à sa droite). Photo : (c) E.-Bauer/OnP
Nouvelles productions
Neuf autres nouvelles productions
sont proposées la saison prochaine. Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns (1835-1921) fait sa
réapparition après quinze ans d’absence. Dirigé par Philippe Jordan et mis en
scène par Damiano Michieletto avec dans les deux rôles titres Anita
Rachvelishvili et Aleksandrs Antonenko, ce spectacle est présenté du 1er au 30 octobre. Cavalleria
rusticana de l’Italien Pietro
Mascagni (1863-1945) est couplé avec Sancta Susanna de l’Allemand Paul Hindemith (1895-1963), seront mis
en regard du 28 novembre au 23 décembre
par le chef Carlo Rizzi et le metteur en scène Mario Martone, et seront chantés
pour le premier par Elina Garanca et Elena Zhidkova qui alterneront dans le
rôle de Santuzza, Yonghoon Lee / Marco Berti en Turiddu et Elena Zaremba /
Stefania Toczyska en Lucia. Nouvelle production attendue, Lohengrin de Richard Wagner (1813-1883) dirigé par
Philippe Jordan et mis en scène par Claus Guth, avec une distribution de
premier plan, puisqu’elle réunit du 18
janvier au 5 février René Pape alternant avec Rafal Siwek (Heinrich), Jonas
Kaufmann / Stuart Skelton (Lohengrin), Martina Serafin / Edith Haller (Elsa),
Wolfgang Koch / Tomasz Konieczny (Telramund) et Evelyn Herlizius / Michaela
Schuster (Ortrud). Un nouveau Cosi fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) est
présenté à Garnier du 23 janvier au 19
février, dirigé par Philippe Jordan et mis en scène par la chorégraphe Anne
Teresa De Keersmaeker, avec une jeune équipe de chanteurs (Jacquelyn Wagner /
Ida Falk-Wiland, Michèle Losler / Stephanie Lauricella, Frédéric Antoun /
Cyrille Dubois, Philippe Sly / Edwin Crossley-Mercer, Paulo Szot / Simone Del
Savio, Ginger Costa-Jackson / Maria Celeng). Carmen de Georges Bizet (1838-1875) sera présentée
vingt-cinq fois (du 7 mars au 14 avril et du 13 juin au 16 juillet) dans
une nouvelle production de Lionel Bringuier (mars-avril) / Mark Elder
(juin-juillet) à la direction et Calixto Bieito à la mise en scène, avec
Roberto Alagna / Bryn Hymel, Roberto Tagliavini / Ildar Abdrazakov, Clémentine
Margaine / Varduhi Abrahamyan / Anita Rachvelishvili / Elina Garanca,
Aleksandra Kurzak / Nicole Kar / Maria Agresta). A noter que la dernière
représentation sera retransmise en direct sur grand écran Place de la Bastille,
où sont espérés plus de trente-cinq mille spectateurs. Jamais donné à l’Opéra
de Paris, le « conte de printemps » Snégourotchka (la
Demoiselle de neige) de Nikolaï
Rimski-Korsakov (1844-1908) fait son entrée au répertoire du 20 avril au 3 mai, dans une mise en scène de Dmitri Tcherniakov et dirigé par
Mikhaïl Tatamikov, avec entre autres Aida Garifullina, Rupert Enticknap,
Martina Serafin et Luciana D’Intino. Beaucoup plus populaire, la
Cenerentola de Gioacchino
Rossini (1792-1868), qui réunira du 10
juin au 13 juillet à Garnier,
autour du chef Ottavio Dantone et du metteur en scène Guillaume Gallienne, Juan
José De Ledn, Alessio Arduini, Maurizio Muraro, Chiara Skerath, Isabelle Druet,
Teresa Iervolino et Roberto Tagliavini. Deux nouvelles productions sont
confiées à l’Académie de l’Opéra de Paris. Owen Wingrave de Benjamin Britten (1913-1976) (19-28 novembre), dirigé par Stephen
Higgins et mis en scène par Tom Creed, et les Fêtes d’Hébé de Jean-Philippe Rameau (1683-1764) (22-25 mars) mis en scène par Thomas
Lebrun et dirigé par Jonathan Williams.
Reprises
Du côté des reprises, Tosca
de Giacomo Puccini dans la mise en
scène de Pierre Audi (17 septembre-18
octobre) dirigé par Dan Ettinger, avec Anja Harteros / Lludmyla
Monastyrska, Marcelo Alvarez et Bryn Terfel, la Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti (14 octobre-16 novembre) d’Andrei Serban, dirigée par Riccardo
Frizza avec Pretty Yende / Nina Minasyan et Arthur Rucinski, les
Contes d’Hoffmann de Jacques
Offenbach (31 octobre-27 novembre)
mis en scène par Robert Carsen, dirigé par Philippe Jordan, avec Sabine Devieilhe,
Kate Aldrich, Ermonela Jaho, Stéphanie d’Oustrac, Doris Soffel, Jonas Kaufmann
/ Stefano Secco, Yann Beuron et Roberto Tagliavini, l’Iphigénie en Tauride de Christoph Willibald Gluck de Krzysztof
Warlikowski (2-25 décembre) à
Garnier dirigée par Bertrand de Billy, avec Véronique Gens, Etienne Dupuis,
Stanislas de Barbeyrac, Ruzan Mantashyan, Wozzeck d’Alban Berg (24 avril-15 mai)
dans la production de Christoph Marthaler dirigée par Michael Schonwandt, avec
Johannes Martin Kränzle, Stefan Margita, Stephan Rügamer, Kurt Rydl, Gun-Brit
Barkmin et Eve-Maud Hubeaux, Eugène Onéguine de Piotr Ilyitch Tchaïkovski dans la mise
en scène de Willy Decker (16 mai-14 juin)
qui sera dirigée par Edward Gardner avec Elena Zaremba, Anna Netrebko / Sonya
Yoncheva, Varduhi Abrahamyan, Peter Mattei, Pavel Cernoch / Arseny Yakolev et
Alexander Tsymbalyuk, et le Rigoletto de Giuseppe Verdi (30 mai-27
juin) de Serge Guth, dirigé par Daniele Rustioni et avec Vittorio Grigolo, Zeljko
Lucic, Nadine Sierra et Kwangchul Youn.
Concerts, récitals, musique de chambre
Le cycle Berlioz annoncé durant la conférence de presse de la saison
2015-2016, se limitera en 2016-2017 à une version concertante de Béatrice et Bénédict dirigée par
Philippe Jordan avec Stanislas de Barbeyrac et Stéphanie d’Oustrac (24 mars). Autres concerts de l’Orchestre
de l’Opéra de Paris, des extraits du Ring de Wagner (15 septembre),
la Symphonie n° 9 en ré majeur de Mahler (16 novembre, Philharmonie de Paris) également dirigés par Armin
Jordan, et un programme Karol Szymanowski/Pascal Dusapin/Richard Strauss dirigé par Susanna
Mälkki (6 avril, Garnier) et qui
verra la création d’Outscape, concerto
pour violoncelle et orchestre de Pascal Dusapin (né en 1955), avec en
soliste Alisa Wellserstein. Côté récitals, Joyce DiDonato (13 novembre),
Rolando Villazon / Sarah Tysman (18 décembre), Ludovic Tézier / Thuy Anh Vuong
(15 janvier), Juan Diego Florez / Vincenzo Scalera (12 mars) et Anja Harteros /
Wolfram Rieger (18 juin). Musique de chambre par les musiciens de l’Opéra de
Paris (8 novembre à Garnier), Midis Musicaux (cinq rendez-vous du 23 octobre au
11 juin), Week-Ends Musicaux (quatre concerts, les 14 et 15 janvier avec des œuvres
de Claude Debussy, Pierre Boulez, Philippe Hurel, Gérard Grisey, André Jolivet, et les 8 et 9 avril autour de Robert Schumann), Concerts-Rencontres à l’heure du déjeuner (du 6 octobre au 1er
juin).
A signaler également, deux
expositions au Palais Garnier, la première est consacrée au peintre-décorateur-théoricien
russe Léon Bakst (1866-1924), du 21 novembre au 5 mars, la seconde à Wolfgang Amadeus Mozart, du
20 juin au 24 septembre.
Locations et réservations sont
ouvertes à partir de demain, jeudi 11 février 2016.
Bruno Serrou
Renseignements :
08.92.89.90.90. Informations abonnements : 01.73.60.26.26 / Etranger :
(+33) 1.71.25.24.23.
www.operadeparis.fr